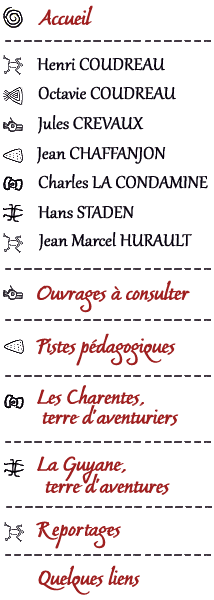
 Octavie Coudreau
Octavie Coudreau«Si je suis explorateur, - ce mot ne supporte pas d'être féminisé, - ce n'est point par amour de la Gloire qui est une déesse bien trop inconstante et encore plus aveugle que la Fortune, ce n'est point, pour l'amour de la Géographie, je crois que j'aimerai énormément la Géographie quand je n'en ferai plus.
Si je fais de l'exploration, c'est pour me permettre de ramener les restes de mon mari auprès de ses vieux parents, c'est pour qu'Henri Coudreau ne demeure pas éternellement sous une terre étrangère bien qu'amie, c'est aussi pour terminer l'œuvre commencée depuis cinq ans, œuvre utile entre toutes puisqu'elle consiste surtout à faire connaître des contrées encore ignorées par les masses». (Voyage au Cumina, 1900)
Après le décès de son mari, Octavie Coudreau poursuivra donc durant sept années les explorations et les travaux de son mari. Déçu par l’attitude des autorités françaises lors de l’affaire du «Contesté franco-brésilien», Henri Coudreau était maintenant passé au service des Gouverneurs des Etats du Brésil désireux d’établir la cartographie des affluents de l’Amazone et de repérer les possibilités d’installations de fermiers ou de forestiers. Pour le compte de l’Etat du Parà, Henri Coudreau était chargé d’explorer le fleuve Trombetas. Récemment mariée, Octavie l’accompagnait.
Mais cette année 1889 reste son pire souvenir. Ce premier voyage se termine tragiquement. C’est la seule expédition qu’ils mèneront ensemble. Le récit de Voyage au Trombetas affluent de la rive nord de l’Amazone est rédigé par Henri Coudreau. Ce dernier est déjà malade et épuisé par des années passées dans « l’Enfer vert ». Atteint de fièvre paludéenne, il meurt dans ses bras le 10 novembre 1899. Avec un courage exemplaire, aidée par ses compagnons de voyage, elle fabrique un cercueil avec les planches du canot et dresse une sépulture sur un promontoire qui domine le lac Tapagem. Après une dernière nuit à veiller cet être qu’elle aimait tant, elle reprend l’exploration. C’est elle qui rédigera les derniers chapitres de l’ouvrage à son retour en France à Angoulême.
En avril 1900, elle repart pour explorer les fleuves Paru et le Murapi. Décidée, infatigable, volontaire, elle fait preuve d’un courage que bien des hommes n’auraient pas au milieu des dangers qu’elle affrontera. Elle a appris auprès de son mari l’usage des appareils et du matériel nécessaire à l’exploration : boussole, photographie, relevés cartographiques et croquis. Autant ses récits de voyage dénotent d’ une sensibilité personnelle (émerveillement devant la nature sauvage, soins quasi maternels prodigués à ses piroguiers malades…), parfois teintée de mélancolie romantique, autant peut-elle faire preuve d’un courage remarquable quand elle affronte la maladie (épuisement, fièvres, blessures) et se montrer autoritaire et de sévère lorsqu’elle n’hésite pas à châtier à coups de liane l’un de ses piroguiers qui lui a désobéi et volé des provisions.
La même année, jusqu’au mois de mai 1901, elle repère et décrit les rivières Cuminà puis Mapuera.
De juin 2002 à janvier 1903, c’est au tour du Maycuru.
Lors de ce voyage, capturée et retenue prisonnière par une tribu indienne elle parvient à s’échapper en assommant et laissant pour mort son gardien. Après avoir erré seule dans la forêt pendant trois jours elle finit par rencontrer un fleuve. Avisant une pirogue, elle descend le cours d’une rivière au plus vite jusqu’à rencontrer un village. Heureusement ses habitants sont plus hospitaliers et elle finit par rejoindre l’Amazone et la ville de Belen, saine et sauve.
Au cours de l’année 1904, Octavie parvient à faire rapatrier le corps de son cher défunt en métropole. Il repose désormais dans le caveau familial à Angoulême.
De septembre 1905 jusqu’en février 1906, elle effectue sa dernière mission à la demande du gouverneur de l’Etat d’Amazonas. Ce sera sur la rivière Canuma, affluent de l’Amazone proche de Manaus. Elle rapportera de ces différents voyages quantité de croquis, de photos et de cartes décrivant le tracé des fleuves explorés. Ces repérages sont autant de données à caractère géographique qu’une prospection afin de trouver les terres propices à des implantations agricoles ou d’exploitation de l’hévéa. L’aventure de la forêt semble déjà se terminer au profit d’une description des potentialités de mise en valeur des terres. Elle mentionne soigneusement « les campos » qui bordent les fleuves. Autant de futures terres agricoles accessibles par les voies navigables. Elle conclut ce dernier ouvrage par ces lignes : « Depuis quatorze ans que je fais des explorations, malgré les peines et les ennuis que j’ai éprouvés, je quitte ma forêt vierge à regret. C’est sans doute parce qu’ayant passé toute ma jeunesse dans le Grand Bois, je me sens étrangère au milieu de la civilisation ».
Au printemps 1906, elle se retirera dans sa maison de Sonnac (Charente Maritime) où elle s’éteindra en 1938.
Curieuse destinée pour cette femme, très éprise de son mari, ayant appris de lui comment organiser et diriger une expédition. Mais Octavie n’est pas uniquement la femme d’Henri Coudreau. Parfois l’élève dépasse le modèle et bien souvent dans ses écrits elle fait preuve d’une acuité d’observation, d’une ouverture d’esprit, d’un vrai talent presque de romancière, pour raconter les péripéties du quotidien qui font d’elle, à la fois un véritable explorateur(trice ?) au courage indomptable, un écrivain de romans d’aventures, qu’elle aurait pu devenir, tout autant qu’une personnalité forte, sensible et attachante.
 Dans le récit du Voyage au Cuminà, Octavie Coudreau relate les événements quotidiens, ses rapports, parfois difficiles avec ses piroguiers, elle prospecte les hautes terres des « campos » dans l’amont des fleuves hors des zones inondables et évalue la possibilité d’exploiter ces terres pour développer l’élevage avec l’implantation de faenzas (fermes brésiliennes).
Dans le récit du Voyage au Cuminà, Octavie Coudreau relate les événements quotidiens, ses rapports, parfois difficiles avec ses piroguiers, elle prospecte les hautes terres des « campos » dans l’amont des fleuves hors des zones inondables et évalue la possibilité d’exploiter ces terres pour développer l’élevage avec l’implantation de faenzas (fermes brésiliennes).
Les campos :
« L'étendue de ces campos est immense : ce sont bien là les campos «geraes» (immenses). Le docteur Crevaux, descendant le Paru, s'étonna de voir à la crique Citaré, un peu au nord, les campos venir accoster à la rivière. De plus, Henri Coudreau, en remontant le Tapanalioni, apprend que celle rivière prend sa source dans les campos qui s'étendent jusqu'aux sources des hauts affluents du Trompetas.
Au Pani, les Piânocotos disent qu’ils marchent toujours dans le campo quand ils vont faire du commerce avec les Roucouyennes du Pari. Ils disent aussi que le campo s'étend très loin vers le sud, mais il est difficile de préciser la distance qu'ils sous-entendent avec leur très loin. Je sais seulement que le campo s'étend de la crique Citaré sur le Pari aux sources du Tapahoni et de l'Oulémari, jusqu’au Paru du Cuminà.
Je partais de Para avec un doute au point de vue de la valeur de ces campos dont je savais l'existence incontestable puisqu'ils avaient été vus par trois personnes dignes de foi et je m'attendais à trouver des campos maigres, rachitiques, n'ayant du campo que le nom, avec un peu d'herbes dures, et ne convenant nullement à l'installation des fazendas (fermes agricoles brésiliennes). Alors mon étonnement est grand, quand je vois se dérouler devant moi, à perle de vue, une immense étendue de terrain couverte d'herbes excellentes.
Mes hommes, qui sont tous des campos de Goyaz ou de Mines, sont comme moi fort enthousiasmés. Je les vois rire, chanter, courir dans le campo, revenir à moi avec les mains pleines d'herbes : «Madame, c'est le campo de Mines, c'est le même campo que celui où je suis né. Ah ! Madame ! Une fazenda ici ! Quel beau bétail on aurait ! » Leur joie est du délire, et ils crient leur joie, ce sont des hurlements à épouvanter un jaguar. Je vais avec eux jusqu'au sommet d'une petite éminence, marchant au milieu d'une herbe haute et drue qui me vient jusqu'à la ceinture. Le campo est vraiment d'une beauté enchanteresse. Quelques broussailles vivent çà et là, mais elles sont rares car le campo est à peu près net.
Je suis émerveillée par de légères ondulations en dos d'âne, des bosselures qui de loin éveillent l'idée de minuscules dunes en formation toutes couvertes d'une herbe verte et tendre. Quelquefois, ces mamelons s'élèvent à une hauteur, qui leur mérite le nom de collines et même de montagnes. Et nous voyons, de ces collines, s'élever majestueuses au milieu du campo ondulant comme les vagues de la mer sous une brise légère.
Des palmiers sont plantés en rangs sur le bord des innombrables petites rivières sinueuses qui traversent le campo. Il n'y aurait donc pas à redouter que le bétail manquât d'eau de bonne qualité, ce
qui est généralement à craindre dans les campos hauts » (p.145-146).
La qualité des campos hauts semble remarquable, mais pour les atteindre il manque les chemins :
Ces campos jouissent d'un climat exceptionnel pour l'Amérique équatoriale. Le jour, la chaleur y est modérée par un vent presque continu, soufflant nord-est, balayant l'atmosphère, purifiant l'air. Je ne puis donner une moyenne du maximum de chaleur diurne. Je suis toujours au milieu de la rivière, aux heures de soleil, et mon temps étant limité, je ne puis faire installer ma tente pour rester dans le campo les quelques jours qui seraient nécessaires à la recherche de l'exacte température maxima à l’ombre. Je puis dire toutefois qu'ici, sous l'équateur, les chaleurs sont bien plus supportables que sous les tropiques, ce qui ne s'explique que par l’influence de la brise.
Les nuits sont fraîches, très fraîches, nous les trouvons même froides et nous devons, pour dormir, nous envelopper dans nos couvertures de laine. Pendant le temps que je suis restée dans le campo le minima du thermomètre m'a donné une moyenne de 19 °.
La fréquence des pluies est à signaler. Pour apprécier la quantité d'eau qu'elles donnent dans ces régions, il faudrait un séjour plus long que celui qu'il m'est permis d'y faire. Je puis dire, cependant, que nous n'avons pas eu deux jours de suite sans pluie.
Officiellement, nous sommes en été. Ici, les saisons se distinguent les unes des autres par l'humidité et les pluies plus que par la température. Il v a température haute toute l'année. La pluie vient toujours de l'est. Malgré l'excellence de ces campos personne n'aurait certainement eu l'idée de pratiquer un chemin pour y arriver si un besoin impérieux ne s'en faisait sentir.
Tous les riverains de l'Amazone, d'Obidos à Almeirim, rêvent des Campos geraes de la Guyane brésilienne. En voici la raison : Sur les bords de l'Amazone, il y a quelques campos avec un peu de bétail : ce sont des campos bas, dans l’ancien lit de la rivière, avec des lacs desséchés l'été reparaissant l'hiver, dont la végétation luxuriante est toutefois de moindre qualité. Arrive la crue de l'Amazone, tous ces campos sont recouverts par l'eau, il ne reste que quelques monticules, refuges insignifiants pour la quantité du bétail.
Dans l'état actuel des rives de l'Amazone, avec la crainte de l'énorme crue, il ne faut pas songer à aménager ces terrains de formation récente et encore mal consolidés : ce serait une grosse dépense pour un maigre résultat. Ces campos bas sont bons l'été pour y laisser provisoirement le bétail en attendant son écoulement sur le marché.
Pour la mise en rapport, pour l'utilisation de ces hauts campos, il est nécessaire d'avoir un moyen facile d'y arriver. Ce système d'accession commode n'est pas aisé à découvrir. La seule idée bonne est encore celle de M. Valentin Couto : ouvrir un chemin qui favorise le transit » (.p149).
Comme Henri Coudreau, (qui tenait également des discours empreint du « colonialisme humaniste de l’époque »), elle voit dans le métissage avec les Indiens une solution à l’implantation de colonies :
« Le croisement de la race blanche avec les Indiens ne peut donner que des résultats satisfaisants : que ce soit pour explorer les plateaux intérieurs ou pour pénétrer l'hostile forêt vierge, il n'y a que les mameloucos qui peuvent prêter avec utilité le secours de leurs bras et de leur intelligence » (.p173).
Parfois elle fait preuve de sévérité avec son équipe :
« Pendant que les autres sont allés à la recherche de notre gibier, José est resté avec moi. Il n'est pas très rassuré. Quand il me voit prendra un sabre d'abatis et aller dans la forêt couper une forte liane, il comprend tout de suite que cette liane lui est destinée. En effet, je lui donne une correction digne de figurer dans ses souvenirs.
Un moment après, j'ai eu regret de l'avoir frappé si fort, je l'appelle et je lui dis :
— T'ai-je fait bien du mal? — Mais n'est-ce pas ta faute? Ne méritais-tu pas cette correction ?
— Non, dit-il en souriant, Madame ne m'a pas fait mal. Une mère bat toujours
son fils avec amour » (p.55).
D’autres fois, elle devient infirmière :
« Je fais l'infirmière, je soigne le pied de Chico et j'essaye de fermer sa blessure toujours ouverte, je perce le doigt de Guilhermo : c'est tout ce que je puis. Je me laisse tomber dans mon hamac en oubliant non seulement de dîner, mais aussi d'allumer mon inséparable cigarette. Je suis dans mon hamac et je voudrais bien dormir. Cela est impossible avec Guilhermo qui, à côté de moi, gémit sur tous les tons. Quand je suis prête à céder à un sommeil réparateur et mérité, un : « Ah ! Jésus ! Aigu, me fait sursauter. Chico se plaint également, mais plus discrètement » (p.88).
Pour se laver, dans la forêt, il n’y a que la baignade, mais ce n’est pas sans danger :
« Je profite de cet instant de répit pour aller me baigner. Je trouve un joli site : c'est un cirque de rochers avec une cascade d'environ 4 mètres de hauteur, l'eau tombe en pluie fine, c'est délicieux et je m'y serais attardée si je n'avais eu la visite d'un indiscret, un énorme sucuriji (un boa). Il manœuvre si bien qu'il s'approche de moi; il n'en est plus qu'à quelques mètres, lorsque je l'aperçois par hasard. J'avoue à ma honte que je ne lui cherche pas querelle, je sors de l'eau et, pendant (que le soleil me sèche, je l'examine à mon aise et à l'abri de toute atteinte : c'est vraiment une belle bête » (P115).
Tristesse et solitude :
« Comme je suis seule des heures entières, j'arrive de rêveries en rêveries à oublier la triste réalité, je ne me souviens plus des ennuis de mon existence et mon moi s'en va loin, très loin, aux pays des chimères. Oh ! Les beaux songes, les doux rêves que je fais à l'ombre des goyaviers sauvages! Tendres songes et rêves réconfortants que jamais personne ne saura et qui seuls procurent un peu de calme à mon âme tourmentée et endolorie, à mon cœur fatigué de tant de souffrances, à mon être qui aspire au bonheur suprême ! […]
Quand la fièvre tient une proie, elle ne la laisse pas facilement. Toute la nuit j'ai la fièvre et le délire. Dès le matin, Estève, qui m'a veillée émet timidement l'idée de retourner. Je le reçois de telle façon qu'il n'aura jamais plus la velléité d'en reparler » (p.62).
« Quant à moi, je vais tristement dans la lumière blanche du ciel bleu, mon esprit inquiet soutire d'un mal sans remède, et, quand viendra l'heure dernière que mon âme ne repoussera pas, elle me sera plus agréable que la tendre clarté du matin qui m'était si doux sous mon beau ciel de France.
Mais il s'agit bien ici des rêves de mon imagination. J'ai autre chose à faire que de la littérature ou du sentiment. Je suis ici pour tracer un levé exact el aussi complet que possible du Rio Cuminà, sous-affluent de l'Amazone » (p.74).
Récit de la mort d’Henri Coudreau
Voyage au Trombetas - 7 Août 1899 — 25 Novembre 1899 – Chap. VIII, p. 120 à p.126 -
H. Coudreau, a rédigé les premiers chapitres du Voyage au Trombetas. Après sa mort, à partir du chapitre VIII, O. Coudreau terminera le récit de cette exploration.
L’ouvrage indique auteur : O. Coudreau « d’après les notes du carnet d’Henri Coudreau ».
CHAPITRE VIII
Descente de la Porteira. — Mort d'Henri Coudreau. — Douloureuse séparation.
Veillée funèbre. — Lac Tapagem. — Retour a Oriximinâ. — Rentrée au Para.
Nous descendons la Porteira qui forme à cet endroit un saut rive gauche. Tout en étant dangereuse la rive droite nous permet, avec le canot vide, de passer sans avaries. Nous voici en bas de ces terribles cachoeiras que nous ne devions pas pouvoir traverser. Maintenant il faut presser le voyage, il v a douze jours que je ne me nourris que de lait, et depuis hier il n'y en a plus. Il est impossible d'en trouver dans ce désert, il n'y a qu'à serrer les dents... et à aller vite. En attendant que je puisse me remettre à manger, mes jambes fléchissent et ne peuvent plus me porter.
Cette phrase est la dernière écrite par Henri Coudreau, le 9 novembre, vers les six heures du soir.
Nous étions dans notre canot. Henri Coudreau, notre chef, était étendu sur des couvertures et se préparait à dormir. Il était affaibli, mais son état ne m'inspirait aucune inquiétude. Le voyant un peu affaissé, je ne voulus pas dormir, et je restai à côté de lui, cherchant à rafraîchir avec mes mains sa tète qui devenait de plus en plus brûlante. Plusieurs fois, il me demanda du lait. Mais de celui que nous avions emporté, une partie avait été consommée à mon insu par deux hommes de notre troupe.
Hélas ! Je ne veux pas les maudire, car il y eut dans leur faute beaucoup d'inconscience. Ces hommes primitifs n'ont pas une haute culture morale, leurs instincts sont bien souvent leurs seuls maîtres. Mais ils me firent souffrir pendant quelques heures le plus pénible et le plus douloureux des supplices.
Je ne pouvais satisfaire le désir d'un malade, d'un mourant, et ce mourant était ce que j'aimais le plus au monde, celui pour lequel j'avais quitté ma famille, ma patrie. Partout où il était allé je l'avais suivi. J'avais vécu de sa vie de labeur, j'avais partagé ses dangers, et je voyais arriver avec une indicible souffrance le moment de la séparation.
La nuit très claire me laissait voir son pauvre et pâle visage. Je sentais qu'il était très mal. Lui cependant me parlait de l'avenir et, comme dans un rêve, faisait de riants projets. J'appelai un de mes hommes pour soulever son oreiller et arranger les couvertures. Il prit le bras de mon mari et le laissa tomber avec stupeur. Lui me dit sans tremblement dans la voix : « Est-ce que j'en serais déjà là ! » Alors je vis qu'au poignet le sang ne circulait plus, il s'amassait en boules.
Henri Coudreau lut-il mon effroi dans mes yeux? ll m'appela d'une voix déchirante, d'une voix où il y avait tout le regret de n'avoir pas assez pleinement joui de la vie qu’il laissait. J'ai lu dans ses yeux la souvenance des bonheurs passés et la douleur amère de me laisser. « Ma Fauvette, ma…»
Ce fut tout, ce fut l'accès pernicieux fulminant dans toute son horreur.
Il était deux heures et demie ! Le désarroi fut complet. Je l'appelai désespérément, j'essayai les frictions, mais rien : ni un souffle ni un mouvement ne répondirent à mes soins. Je ne pouvais plus garder d'espoir. Je levai la tète vers le Ciel, sondant l'Infini, écoutant si je n'entendais pas au fond de mon âme quelque voix mystérieuse qui me parlerait secrètement à travers l'étendue. Rien ! Mes yeux appesantis regardèrent de nouveau mon mort bien-aimé.
Les hommes allumèrent autour de lui tout le luminaire dont nous pouvions disposer. C'était un spectacle navrant et terriblement beau que celui de cette illumination funèbre au milieu des eaux noires avec, au-dessus de nos têtes, un ciel constellé d'étoiles. Il nous fallut attendre le jour pour trouver un coin de terre. Le soleil se leva inconsciemment radieux et rendit plus pénible encore ma veillée de mort.
Nous étions en face du lac Tapagem rive gauche. Il y a là quelques collines. C'est l'endroit que j'ai choisi pour qu'il puisse dormir tranquille de son dernier sommeil.
Nous n'avions pas de bois pour faire son cercueil. J'ai fait enlever les planches d'un canot et je suis restée là presque sans vie toute la journée, entre mon mari mort et les hommes faisant le cercueil à côté de moi et me distrayant à chaque instant de ma douleur, pour me demander comment il fallait s'y prendre.
Chaque coup de marteau retentissait dans mon cœur, et j'ai supporté cette peine pendant plusieurs heures, et je ne suis pas morte d'émotion. Aujourd'hui, je me demande comment cela a pu se faire, et pourquoi je suis encore
de ce monde, comment j'ai résisté à de pareilles secousses ! Les hommes emportèrent le cercueil de celui qui toujours avait été bon et doux pour eux. Je les suivis, brisée.
Comme Jésus, j'ai monté mon calvaire, mais il m'eût été moins douloureux de marcher comme lui au gibet que de conduire à sa dernière demeure le compagnon de ma jeunesse, celui qui avait été pour moi un ami, un père, un frère, un époux.
Lorsque la funèbre tâche fut terminée, je fis attacher mon hamac à côté de la tombe, el je me dis : « Désormais je vais rester ici, j’y mourrai pour ne pas être séparée de son corps, même dans la mort. »
J'y demeurai cette première nuit, puis une seconde.
Mais pourquoi n'y suis-je point encore?...
Est-ce pour revoir la France ? Non. Pour aller trouver ma mère, ma sœur, ma chère petite Jeanne ? Non. Pour finir la tâche qu'il avait commencée ? Non. Alors... alors, je ne sais pas. Pourtant la mort aurait été meilleure en ce moment aux côtes de mon pauvre mort; elle m'aurait été douce près de sa tombe, dans la forêt vierge des bords du Trombetas.
Aussi est-ce du fond de mon cœur que je dis avec le poète
« Et toi, divine mort, où tout rentre et s'efface,
« Accueille tes enfants dans ton sein étoilé,
« Affranchis-nous du temps, du nombre et de l'espace,
« Et rends-nous le repos que la vie a troublé.
Pour revenir à Oriximinâ, je ne voulus marcher que la nuit : c'était trop triste de revoir seule les lieux que nous avions explorés ensemble. Nos canots, ayant à l'avant chacun une faible lumière, marchaient sur les eaux noires pendant l'obscurité de la nuit.
C'était bien une descente funèbre, une promenade des morts, la course éperdue d'une âme qui n'a plus le souffle qui pouvait lui faire accepter la vie.
En savoir plus :
Les ouvrages d’Octavie Coudreau étant difficiles à se procurer, certains sont téléchargeables gratuitement et libres de droits (choisir dans le menu de gauche le format PDF) :
Voyage au Cumina http://www.archive.org/details/voyageaucumin1901coud
Voyage au Trompetas http://www.archive.org/details/voyageautrombeta00coud
Voyage à la Mapuera http://www.archive.org/details/voyagelamapuera00coudgoog
