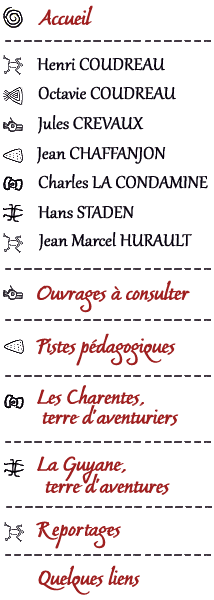
 Hans Staden
Hans StadenVéritable histoire et description d’un pays habité par des hommes sauvages, nus et anthropophages, situé dans le Nouveau Monde nommé Amérique inconnu dans le pays de Hesse avant et depuis la naissance de Jésus-Christ, jusqu’à l’année dernière.
Hans Staden de Homberg en Hesse l’a connu par sa propre expérience et le fait connaître actuellement par le moyen de l’impression à Marbourg.
Tel est le titre de l’ouvrage que Hans Staden fait paraître en 1557 dans lequel il raconte cette captivité de neuf mois qui a conservé jusqu’à nos jours une valeur documentaire unique.
Pour les ethnographes, ce témoignage est, avec l’ouvrage d’André Thevet, Les Singularités de la France Antarctique publié la même année, un des textes fondateurs de l’ethnographie américaine. « Admirablement présenté, avec toutes les illustrations de l’édition originale, un des témoignages les plus sensationnels et certainement le plus pittoresque que nous possédions sur les Indiens du Nouveau Monde à l’époque de la découverte » dira Claude Lévi-Strauss (Lettre à l'éditeur).
 Un récit hallucinant
Un récit hallucinant Hans Staden, Allemand de Hambourg, était donc parti pour visiter les « Indes », plus exactement l’Amérique qui venait d’être découverte par Christophe Colomb en 1492, suivi bientôt par nombre d’aventuriers, de conquistadores, de navigateurs avides de gloire et des richesses du nouveau continent. Les navigateurs portugais installèrent des comptoirs sur la côte est de l’Amérique du sud (aujourd’hui le Brésil). Pris dans une tempête, Staden fait naufrage dans l’île Saint-Vincent. L’île est habitée par trois tribus, la première, appelée Tuppins Ikins, est alliée aux Portugais, par chance les marins touchent terre sur leur territoire. La deuxième, qui vit dans le nord de l’île, les Tuppins Inbas sont leurs ennemis irréductibles. La dernière tribu, Les Carios, vivent dans le sud et sont également considérés comme des ennemis redoutables. Mettant à profit ses connaissances en artillerie, Hans Staden participe à renforcer les défenses du fortin de Brikioka, fréquemment attaqué par « les sauvages », il prévoit d’y rester plusieurs mois dans l’attente d’un bateau qui le ramènerait vers le Portugal.
Malheureusement, alors qu’il allait chasser en forêt il est attaqué par un groupe appartenant à la tribu des Tuppins Inbas. Battu, blessé, capturé, il est entraîné par ses ravisseurs dans leur village. « Je priais en attendant le coup de la mort ; mais le roi, qui m’avait fait prisonnier, prit la parole, et dit qu’il voulait m’emmener vivant pour pouvoir célébrer leur fête avec moi, me tuer et, « kawewi pepicke », c'est-à-dire faire leur boisson, célébrer une fête et me manger ensemble ».
Hans Staden comprend alors qu’il est prisonnier d’une tribu qui pratique le cannibalisme. Ramené au village, bien qu’effrayé, il observe et note les coutumes et les rituels de la tribu.
« Les femmes m’entraînèrent, me prenant les unes par les bras, les autres par la corde, qu’elles serraient tellement, que j’avais de la peine à respirer. Je ne savais pas ce qu’elles voulaient faire de moi ; mais je me consolais en pensant aux souffrances de Notre Seigneur Jésus-Christ. Elles me conduisirent ainsi devant la cabane du roi, qui se nommait Vratinge Wasu, c'est-à-dire le Grand Oiseau Blanc ; elles me couchèrent sur un grand tas de terre qui se trouvait devant la porte. Croyant que ma dernière heure était venue, je regardais de tous côtés pour voir si on n’apportait pas l’Iwera pemme, c’est ainsi qu’on appelle l’espèce de massue avec laquelle on assomme les prisonniers. Une femme s’approcha alors avec un morceau de cristal attaché entre deux baguettes et me rasa les sourcils ; elle voulut aussi me couper la barbe, mais je l’en empêchai en disant que je voulais mourir avec ma barbe. Elles répondirent qu’elles ne voulaient pas encore me tuer et consentirent à me laisser ».
Les journées suivantes le prisonnier doit subir d’autres rituels tels que des danses devant des objets sacrés et des statuettes d’idoles.
 L’ennemi c’est le Portugais, or Staden n’est pas Portugais, l’espoir renait…
L’ennemi c’est le Portugais, or Staden n’est pas Portugais, l’espoir renait… Le chef du village lui explique que les Portugais ont tué plusieurs hommes de la tribu, aussi doit-il se venger. Staden n’est pas Portugais, il parle plusieurs langues, dont des langues indiennes, et comprend que son seul alibi serait de se faire passer pour un Français ; les Français étant alors en rivalité avec les portugais, ils commercent de temps à autre avec la tribu. Il achètent en particulier du bois, du coton, du poivre en échange d’objets : couteaux, haches, miroirs, peignes, ciseaux… il va donc essayer de se faire passer pour un Français, mais qui va le croire ?
Cependant les Indiens, alliés des Portugais étaient partis à sa recherche et un matin, arrivés avec vingt-cinq canots, ils attaquèrent le village. Peut-être une occasion inespérée de s’échapper ?
« Je dis alors aux Indiens : vous me prenez pour un Portugais, votre ennemi ; hé bien, ôtez-moi ces liens et donnez-moi un arc et des flèches, et je vais vous aider à défendre votre village. Ils y consentirent et je me joignis à eux, en criant et lançant des flèches comme eux, les excitant à avoir bon courage et à ne rien craindre. Mon intention était de traverser les palissades et de me joindre aux assaillants, car ils me connaissaient bien, et savaient que j’étais dans le village ; mais on me gardait trop bien, et les Tuppins Ikins voyant leur coup manqué, retournèrent à leurs canots et se rembarquèrent. Dès qu’ils furent partis on me remit mes liens ».
Tout reste donc à recommencer et Staden tente d’autres stratagèmes : être un peu sorcier et lorsque la lune éclaire la cabane du chef de village, le menacer d’un malheur à venir. Ou bien s’improviser guérisseur, ce qui ne marche pas la première fois, mais par chance ou hasard l’un des chefs et sa femme guérissent. Mieux considéré, sa situation s’améliore mais son état de prisonnier demeure.
« Les vieilles femmes du village, qui m’avaient le plus maltraité et accablé de coups et d’injures, commencèrent aussi à s’apaiser et me dire : « Scheraeire », c'est-à-dire, mon fils, conserve-moi la vie. Quand nous t’avons maltraité, c’est que nous te prenions pour un de ces Portugais que nous haïssons. Nous en avons déjà beaucoup pris et mangé ; mais alors leur Dieu n’a pas été irrité contre nous comme le tien à cause de toi, ce qui prouve bien que tu n’es pas l’un des leurs ».
Lorsqu’un ennemi est capturé, Indien d’une autre tribu ou Portugais, Staden assiste aux rituels des scènes d’anthropophagie :
« Ce n’est pas parce qu’ils manquent de vivres, mais par haine qu’ils dévorent le corps de leurs ennemis. Pendant le combat chacun crie à son adversaire : « Que tous les malheurs tombent sur toi, que je vais manger. Je te briserai la tête aujourd’hui. Je viens pour venger sur toi la mort des miens. Je ferai rôtir ta chair avant que le soleil soit couché ».
 Les cérémonies
Les cérémonies
« Quand les prisonniers arrivent au village, les femmes et les enfants les accablent de coups ; on les couvre ensuite de plumes grises, on leur rase les sourcils, et l’on danse autour d’eux. […] Au bout d’un certain temps ils font les préparatifs, fabriquent de la boisson et une espèce de vase destiné à mettre la couleur avec laquelle ils les peignent. […] La veille du jour du massacre, ils commencent à boire, attachent autour du cou du prisonnier la corde qu’ils nomment « massarana », et peignent la massue, nommée « iwera pemme », avec laquelle il doit être assommé. Ensuite ils peignent la figure du prisonnier, et pendant qu’une femme est occupée à cette opération, toutes les autres chantent autour de lui. Aussitôt qu’ils commencent à boire on amène le prisonnier. […] Après avoir bu tout un jour, ils construisent une petite cabane où le prisonnier doit se coucher. Le matin, longtemps avant l’aurore, ils se mettent à danser autour de la massue qui doit servir au supplice ; dès que le soleil est levé ils vont chercher le prisonnier ; […] Une femme arrive alors avec la massue garnie de touffes de plumes tournées en haut. Le principal chef s’avance alors, la prend, s’approche du prisonnier et lui dit : Me voici ! Je viens pour te tuer, car les tiens ont tué et dévoré un grand nombre des miens. Au même instant l’exécuteur lui assène sur la tête un coup qui fait jaillir la cervelle. Les femmes s’emparent alors du corps, le traînent auprès du feu, lui grattent la peau pour la blanchir. Lorsque la peau est bien grattée, un homme coupe les bras, et les jambes au-dessus du genou. Quatre femmes s’emparent des ses membres, et se mettent à courir autour des cabanes en poussant des cris de joie. On l’ouvre ensuite par le dos et on se partage les morceaux. Les femmes prennent les entrailles, les font cuire, en préparant une espèce de bouillon qu’elles partagent avec les enfants ; elles dévorent aussi les entrailles, la chair de la tête, la cervelle et la langue. Les enfants mangent le reste. Aussitôt que tout est terminé, chacun prend son morceau pour retourner chez lui. […] J’ai vu toutes ces cérémonies, et j’y ai assisté ».
On reste fasciné par ce récit froid, méthodique, factuel dans la succession événementielle du déroulement des rituels. Par ailleurs, pour l’européen de la Renaissance, Staden, comme ses lecteurs de l’époque, sont confrontés au mythe inquiétant de la dévoration. Tabou qui reste le plus sacré de l’interdit social. A côté de l’image de l’Indien couvert d’or et de plumes rapporté par les conquistadores espagnols, l’Europe découvre « l’autre image », celle qui associera les Indiens aux « sauvages » et confortera la bonne conscience occidentale. Cependant, à l’époque, les rares lecteurs des ouvrages de Hans Staden ou d’André Thevet sont les lettrés humanistes du XVIe. Ces récits pour effrayants qu’ils soient permettent, dès cette époque, pour les plus clairvoyants, de relativiser notre propre conception de la civilisation, notre éthique, nos mœurs. L’Europe vit alors dans d’autres atrocités, celles des guerres de religion. Meurtres gratuits, cruauté, torture étaient pratique courante entre catholiques et huguenots. Comme le souligne Montaigne dans son fameux chapitre sur les Cannibales, le rite de l’anthropophagie avait lieu après la mort et n’avait rien de cruel pour la victime qui acceptait son sort sans horreur :
« Je pense qu’il n’y a pas plus de barbarie à manger un homme vivant qu’à le manger mort ; à déchirer par tourments et géhennes un corps encore plein de sentiment, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux (comme nous l’avons non seulement lu mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pis est sous prétexte de piété et de religion) que de rôtir et manger après qu’il est trépassé ».
Hans Staden, durant ses neuf mois de captivité, est donc le témoin des ces pratiques et, chaque jour il imagine que le moment arrivera où il sera, lui, l’objet du sacrifice. Sa stratégie : gagner du temps et multiplier les ruses. Il a fini par faire admettre qu’il n’était pas Portugais et qu’il attend un bateau français, chargé de présents pour la tribu. Bon observateur des pratiques magiques des Indiens, il parvient à surprendre ses gardiens et les chefs de la tribu en simulant un miracle. Une croix qu’il avait plantée lui ayant été volée, la pluie commença à tomber en fortes averses, plusieurs jours durant, au risque d’endommager les récoltes. Par superstition, on l’aida à en fabriquer une autre, et (par chance ?) la pluie s’arrêta. « Le temps s’éclaircit et ils s’écrièrent que mon Dieu faisait ce qu’il voulait ». D’autres péripéties, d’autres sacrifices rituels, jusqu’au jour où un bateau français, La Catherine de Vatteville, mouille au large. Ce n’est pas la première fois qu’un bateau ami pourrait le tirer d’affaire, mais ayant connu plusieurs espoirs déçus, la méfiance est de mise. Enfin, après des palabres qui lui semblent interminables, avec le truchement d’un marin se prétendant son frère, Staden est échangé contre une partie de la cargaison, et après une négociation qui aurait pu échouer jusqu’au dernier moment, il est finalement sauvé. Le bateau fait voile vers Honfleur. Par Dieppe, Londres, Anvers, Staden peut enfin retrouver son pays et sa famille en 1555, après presque dix ans d’absence.
 Le choc des images (ou l’invention du photo reportage ?)
Le choc des images (ou l’invention du photo reportage ?) Deux années plus tard, parait son ouvrage accompagné de 50 planches gravées. Avec le début de l’imprimerie, la diffusion de documents visuels, que l’on n’avait jamais vus jusqu’alors, illustrant le propos, constitue une véritable révolution. Cette iconographie devait connaître un réel succès. « C’est elle qui a inspiré toute la vision de l’anthropophagie rituelle jusqu’à nos jours » (Marc Bouyer, préface à la réédition de 2005). A la fin du XVIe siècle, Théodore de Bry, disciple de Durer, reprendra les thèmes de ces gravures, L’édition de 1592 (Francfort) de Théodore de Bry, pour des raisons techniques mais également esthétiques, s’éloigne de la version originale de 1557 (Marbourg). L’Indien est moins informe, moins frustre. Peut-être est-on déjà entré dans les débats autour du « bon sauvage », de « l’état de nature », de « la civilisation » qui passionneront les philosophes, du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours ? Cette représentation des peuples dits « primitifs », cette approche iconographique du monde amérindien se retrouvera dans tous les récits des explorateurs, et les illustrations de leurs ouvrages témoignent, à leur manière, de la vision colonisatrice de l’époque.
Jean-Paul Duviols relève, dans la préface à l’édition de 2005, que « Les « sauvages américains » et en particulier les Tupinambas (présents aussi dans les récits de Thevet et Léry) ont joué un rôle essentiel dans l’évolution des idées humanistes de la Renaissance ; leur image originelle et idéalisée permettait de faire ressortir en contraste les vices et la corruption des hommes civilisés de l’Europe : « C’est une nation - dit Montaigne - en laquelle il n’y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance de lettres, nulle science des nombres, nul nom de magistrat ou de supériorité politique, nul usage de service, de richesse ou de pauvreté, nuls contrats, nulles occupations qu’oisives, nul respect de parenté que commun, nuls vêtements, nulle agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé ; les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation , l’avarice, l’envie, la détraction, le pardon, inouïes ».
Considérations et débats toujours ouverts entre « l’état sauvage naturel » et « la barbarie civilisée ».